Leïla Sebbar, un regard féministe entre deux rives
À l’occasion de la participation de Leïla Sebbar au débat de Place publique sur le thème « Guerre d’Algérie, quelles mémoires dans les familles ? » le jeudi 28 avril, La Bibliothèque vous propose une rencontre à la bibliothèque Bellevue afin de découvrir son œuvre portée par un regard féministe.
« Brune, frisée, les yeux bruns. De ma mère française, j’ai le nez gascon, de mon père algérien, j’ai les pommettes hautes et le teint mat. Une enfance enfermée dans la Colonie et la guerre, m’a imposé le regard prédateur de l’écrivain. »

Romancière, essayiste, critique littéraire, Leïla Sebbar a construit son œuvre autour de trois préoccupations principales qui souvent s'entrecroisent dans un même livre : l'exil, la langue et la condition de la femme.

Manifestation à Paris. Nancy Huston derrière Leïla Sebbar ; à leur droite, Marie-Odile Delacour et Julien Bellour ; à leur gauche, Catherine Leguay et Thomas Bellour.
« Nous avons fait un journal de femmes qui n’oubliait ni le quotidien ni les arts ni les lettres ni les ouvriers ouvrières ni la politique ni les petites chansons populaires, les tubes de ces années-là.» (p.152. Le pays de ma mère. Voyage en Frances).
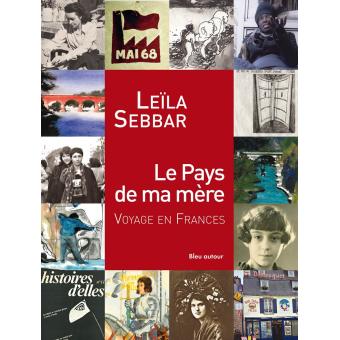
Par ailleurs, elle collabore à la revue Sorcières, fondée par Xavière Gauthier. En 1981, la parution d'une enquête intitulée Des femmes à la maison, anatomie de la vie domestique révèle l’implication des femmes dans la maison et dans le soutien familial : véritable sujet novateur et tabou à l’époque.
En outre, Leïla Sebbar choisit la chambre pour explorer davantage la vie des femmes. « Ce creuset de nos vies, cristal de nos mémoires, lieu d’intimité, lieu d’emprunt, transitoire, niché dans des hôtels et des ports, menacé par le conflit, la séparation, ou la guerre ».
Dans ces chambres, « il y a des femmes surtout, bien plus rivées à la chambre que les hommes qui vont et viennent et pourtant qui détiennent la clé et le pouvoir des lieux. On lit « la chibania » admirable récit de vie d’une femme à travers ses chambres successives : chambre nuptiale, chambre de la couturière à domicile, chambre d’hôtel à Marseille où elle rejoint son mari mourant. De telles histoires sont rares. Habituellement, les hommes disposent du temps et des femmes. Celles-ci résistent pourtant. Elles désirent, elles transgressent comme « Graziella », la Berbère qui revendique son droit d’aimer un Français » (Dans la chambre. préface de Michelle Perrot).
Une plume au service des femmes porteuses de mémoire
Leïla Sebbar publie son premier roman Fatima ou les Algériennes au square qui raconte la vie des femmes immigrées et de leurs filles dans les cités HLM de France.
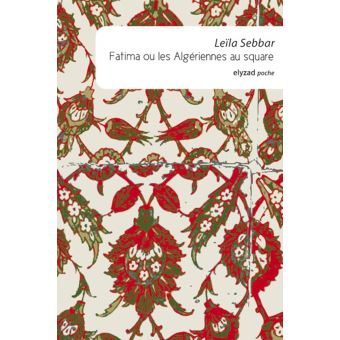
Suivront la trilogie Shérazade, l'histoire d'une jeune femme en quête d'identité qui découvre de nouveaux espaces, ainsi qu’une dizaine de textes qui décrivent toutes ces femmes, mères, jeunes filles affranchies ou non comme cette mère soucieuse des traditions dans Parle à ta mère, une mère au foyer qui passe l’été à la ferme familiale et qui est fascinée par la langue, la courtoisie, l’étrangeté des saisonniers maghrébins dansMarguerite et le colporteur aux yeux clairs ouDes femmes au bainqui disent le désir, le plaisir, l’amour et croisent les légendes.
Sans oublier la correspondance avec Nancy Huston, Lettres parisiennes : autopsie de l'exil dans laquelle ces deux écrivaines, l’une exilée d’Algérie et l’autre du Canada, se questionnent sur le déplacement, l'intégration, et la place des femmes.
Correspondance Nancy Huston /Leïla Sebbar
« De la fenêtre d’une chambre fictive, je regarde et j’écris, à la frontière »
dit L. Sebbar, "passeuse entre deux rives ».
Leïla Sebbar poursuit son observation sur son blog Femme à la fenêtre.
Une écrivaine inspirée par des femmes exceptionnelles
« Le peuple des femmes change le monde et la France où elles vivent, pensent, agissent. Turbulentes, insolentes, elles font trembler les maisons endormies, les palais politiques, elles occupent la place publique, elles quittent le lieu de leur exil imaginaire » (p.108. Le pays de ma mère. Voyage en Frances).
Les figures transgressives de femmes cavalières, guerrières, savantes, exploratrices ou militantes traversent l’œuvre de L. Sebbar : de Jeanne d’Arc à Isabelle Eberhardt et ne cessent de réinterroger la place de la femme dans l’Histoire.
Jeanne, Isabelle, Annemarie, Ella, Alexandra, George, Flora, Louise, Olympe… Les transfuges magnifiques. Féminin. Masculin » (p.97. Le pays de ma mère. Voyage en Frances).
Leïla Sebbar au miroir d'Isabelle l'Algérien
Le personnage d'Isabelle Eberhardt traverse littéralement l'œuvre de Leïla Sebbar. Elle est "toujours là", "partout où [elle] écrit", au croisement de l'intime et du politique. Travestie en cavalier arabe, elle transgresse tous les interdits occidentaux, vivant en accord avec la terre d'exil qu'elle s'est choisie : l'Algérie. Elle est Si Mahmoud Saadi, jeune lettré arabe nomade parcourant à cheval le désert. Isabelle est une "compagne de route fidèle" permettant à Leïla Sebbar de renouer avec la terre paternelle, avec sa langue et son peuple. Comment Leïla Sebbar raconte-t-elle ce compagnonnage obsédant ? À la croisée de chemins menant invariablement au père, Isabelle est toujours une énigme à déchiffrer. (Manon Paillot, Professeure agrégée de lettres modernes, spécialiste de l'œuvre de Leïla Sebbar).

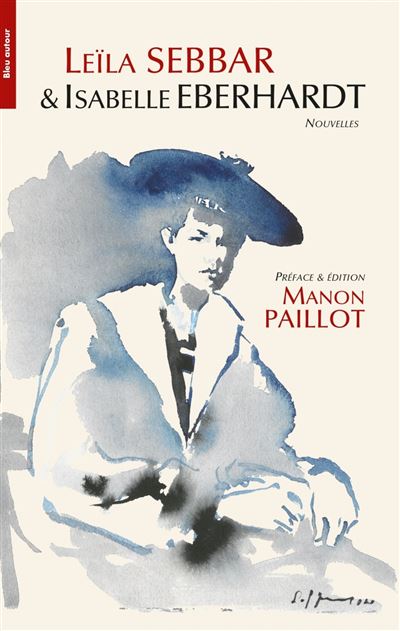

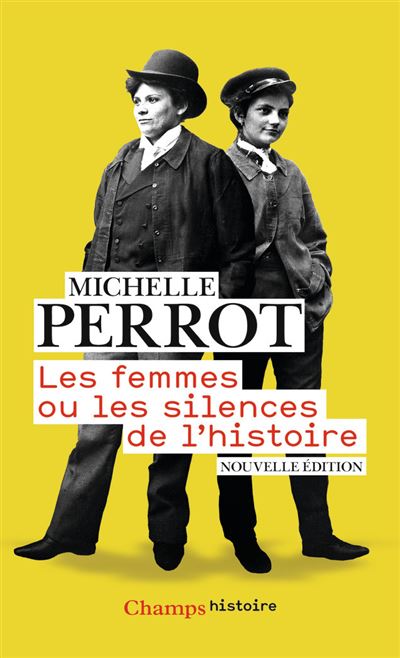
Quelques repères bibliographiques :
Née à Aflou en 1941, petite ville algérienne, d'un père algérien et d'une mère française, tous deux instituteurs dans l’Algérie coloniale, Leïla Sebbar quitte son pays natal en 1961 et débute des études de lettres à l'université d'Aix en Provence avant de rejoindre Paris en 1963 où elle devient professeur de lettres tout en poursuivant son travail de recherche. Elle publiera sa thèse, Le mythe du bon nègre dans la littérature française coloniale au 18e siècle.
Autrice prolifique, L. Sebbar participe à de nombreuses collaborations ou dirige des ouvrages collectifs tels que L’Algérie en héritage. Le Silence entre deux rives, roman sur l’exil et la mémoire, reçoit le Prix Kateb Yacine en 1993.
D’ailleurs, la trilogie autobiographique autour du silence paternel et de l’héritage familial dans Je ne parle pas la langue de mon père, le chant secret de l’arabe et Lettre à mon père fait écho au Pays de ma mère. Voyage en Frances.
En outre, dès 2013, l’IMEC (Institut Mémoires d’édition contemporaine) a constitué un fonds d’archives personnelles de Leïla Sebbar comportant des manuscrits des œuvres, des épreuves et des textes dactylographiés, des correspondances (notamment avec Nancy Huston) et des documents de recherche autour des ouvrages. On trouve également de la presse, le courrier des lecteurs et un ensemble d'archives audiovisuelles. L'IMEC a interrogé son engagement féministe lors de séminaires.



